Bonjour à toutes et tous ! Pendant les vacances de Noël, je me suis à nouveau lancée dans un projet un peu long : découdre pour recoudre un vieux costume afin de le rendre plus historique et ça m’a donné envie de vous partager mes réflexions autour du fait de défaire et refaire, que j’ai envie d’élever au rang d’art de vivre.
Défaire, c’est savoir où l’on va
Si vous me lisez depuis longtemps, vous savez qu’il n’est pas rare que je reprenne un vieux costume pour l’améliorer. La première raison est économique : les matières premières d’un costume coûtent cher donc il n’est pas question de ne le porter qu’une fois. Or, si je ne le juge pas suffisamment qualitatif ou s’il y a des problèmes de seyant, il faut bien le reprendre pour pouvoir le reporter.

Outre cet aspect très pratico-pratique, il y a aussi le fait d’avoir passé beaucoup de temps sur un projet, raison suffisante pour ne pas avoir envie de le laisser dormir dans un placard réel ou virtuel et de le reprendre pour lui donner une seconde vie. Par ailleurs, à titre personnel j’aime beaucoup retravailler quelque chose qui existe déjà, et pas seulement en couture. C’est un processus qui ne demande pas la même réflexion que créer un nouveau projet à partir de zéro. Le chemin est déjà balisé et les étapes à mettre en place pour arriver au bout paraissent plus simples car il n’y a qu’à les suivre.
Certes, découdre des dizaines de mètres de couture machine parce que ce n’est pas historique prend beaucoup de temps, mais c’est surtout un processus méditatif qui ne demande aucun effort.
Quand je suis fatiguée, je trouve très agréable de me lancer dans l’amélioration d’un vieux projet. Le fait que les étapes soient balisées est reposant, tout en ayant l’impression de faire quelque chose d’utile plutôt que de rester écrasée sur mon canapé à scroller sur mon téléphone.

Le confort des retouches contre l’angoisse de la page blanche
Quand on veut se lancer dans un projet ambitieux (qu’il s’agisse d’écrire un roman comme de se lancer dans la couture d’un vêtement que l’on n’a jamais cousu par exemple), on peut se sentir terrassé·e par l’ampleur de la tâche et ne pas réussir à se mettre en mouvement. Quand il y a tout à faire et pas de référentiel, ça peut être difficile de trouver la motivation pour sortir de notre apathie naturelle.
Combien de fois ai-je procrastiné sur la mise en route d’un projet parce qu’il me semblait trop difficile et que je ne me sentais pas en capacité mentale de m’y attaquer ?
Tandis que défaire quelque chose qui existe pour le refaire, ce n’est pas une page blanche, c’est déjà concret. Je ne dis pas que cela nous empêche d’avoir la flemme de nous y mettre (ça doit faire trois ans, par exemple, que je dois retoucher les emmanchures d’une chemise parce que j’ai monté les manches à l’envers), mais que c’est un bon moyen de lutter contre l’angoisse de la page blanche. La flemme, c’est un autre sujet, dont on pourra reparler à l’occasion. ^^
La peur de la fin ?
On pourrait penser que cette propension à toujours revenir sur de vieux projets pour les améliorer s’apparente à du perfectionnisme et à une peur de finir, mais je ne crois pas que ce soit toujours vrai.
Personnellement, je fonctionne beaucoup par essais/erreurs. Alors que la planification a plutôt tendance à me paralyser, j’ai besoin de « mettre les mains dans le cambouis » pour tester, mais sans savoir exactement comment m’y prendre. Cette façon de fonctionner implique nécessairement que je fasse en permanence des choses imparfaites puisque je me lance sans savoir les faire. Il y a donc beaucoup d’aller-retours avant que je sois satisfaite d’un résultat.
Or, ces aller-retours peuvent prendre du temps, parfois des années. C’est par exemple le cas avec mes projets de romans (je vous renvoie au contenu de cette lettre qui détaille notamment la genèse de mon roman en cours), mais c’est la même chose avec le costume historique : j’apprends en même temps que je fais, ce qui implique des imprécisions et des choses qui ne me conviendront plus avec un peu plus d’expérience.
« Le mieux est l’ennemi du bien » ? Peut-être, mais moi j’aime l’idée d’un long work in progress et d’étapes intermédiaires. La seule chose qui compte, il me semble, c’est d’être à l’écoute de ses propres envies et de suivre sa motivation.
Cet état d’esprit va à contre-courant des modèles de la société capitaliste où il faut faire toujours plus, consommer toujours plus, posséder toujours plus. Tandis que vous pouvez porter toujours le même costume, à chaque sortie un peu amélioré, vous pouvez écrire et réécrire le même roman toute votre vie et je trouve qu’il y a quelque chose de beau à cette sobriété.
J’arrête ici ces réflexions. Je suis curieuse d’avoir vos avis et d’en apprendre plus sur votre rapport au fait de défaire et refaire. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour vous parler d’un lieu idéal. Bonne semaine.
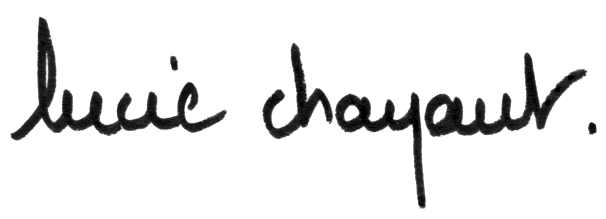




Bonjour, ta réflexion est très intéressante, et m’a poussée à l’introspection. Je pars de mes deux enfants qui ont avec le fait de finir deux pratiques carrément opposées. L’une adore finir, garde toujours le meilleur pour la fin … l’autre ne finit rien, pas même une bouteille d’eau minérale gazeuse … sa chambre est un cimetière de bouteilles presque vides ! Je crois que je suis plutôt comme lui et si je reprends (ou pas, mais savoir que c’est possible me suffit) m’évite l’angoisse d’avoir à finir, de façon basique. Ma procrastination va dans le même sens. Ça me donne aussi l’impression que l’objet est toujours vivant, et j’aime bien ça, même si je suis plus artisane qu’artiste. Il me semble que Bonnard allait subrepticement au musée retoucher ses propres œuvres exposées.
Sinon, quel plaisir de lire des textes qui font le lien avec la politique et la critique du capitalisme, je t’en remercie.
Merci à toi !